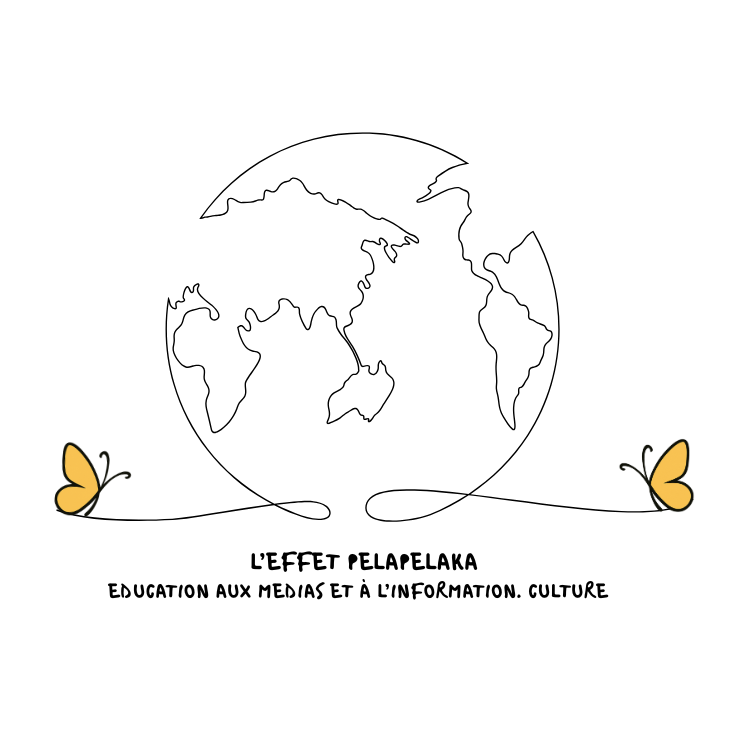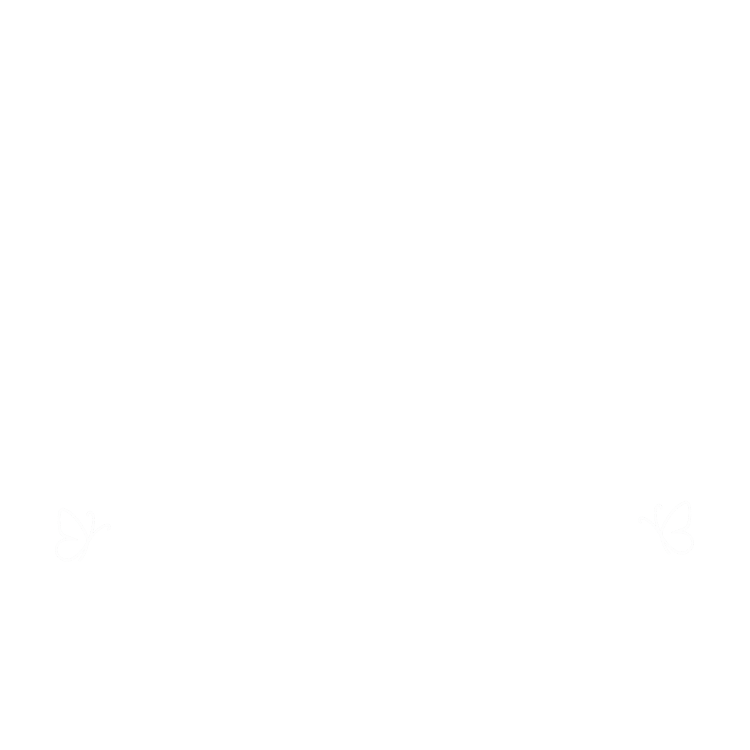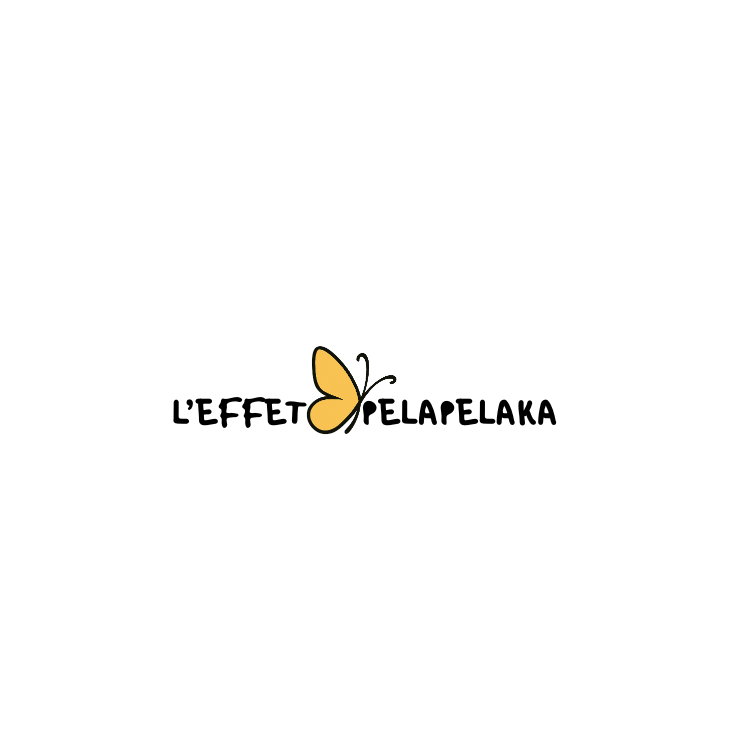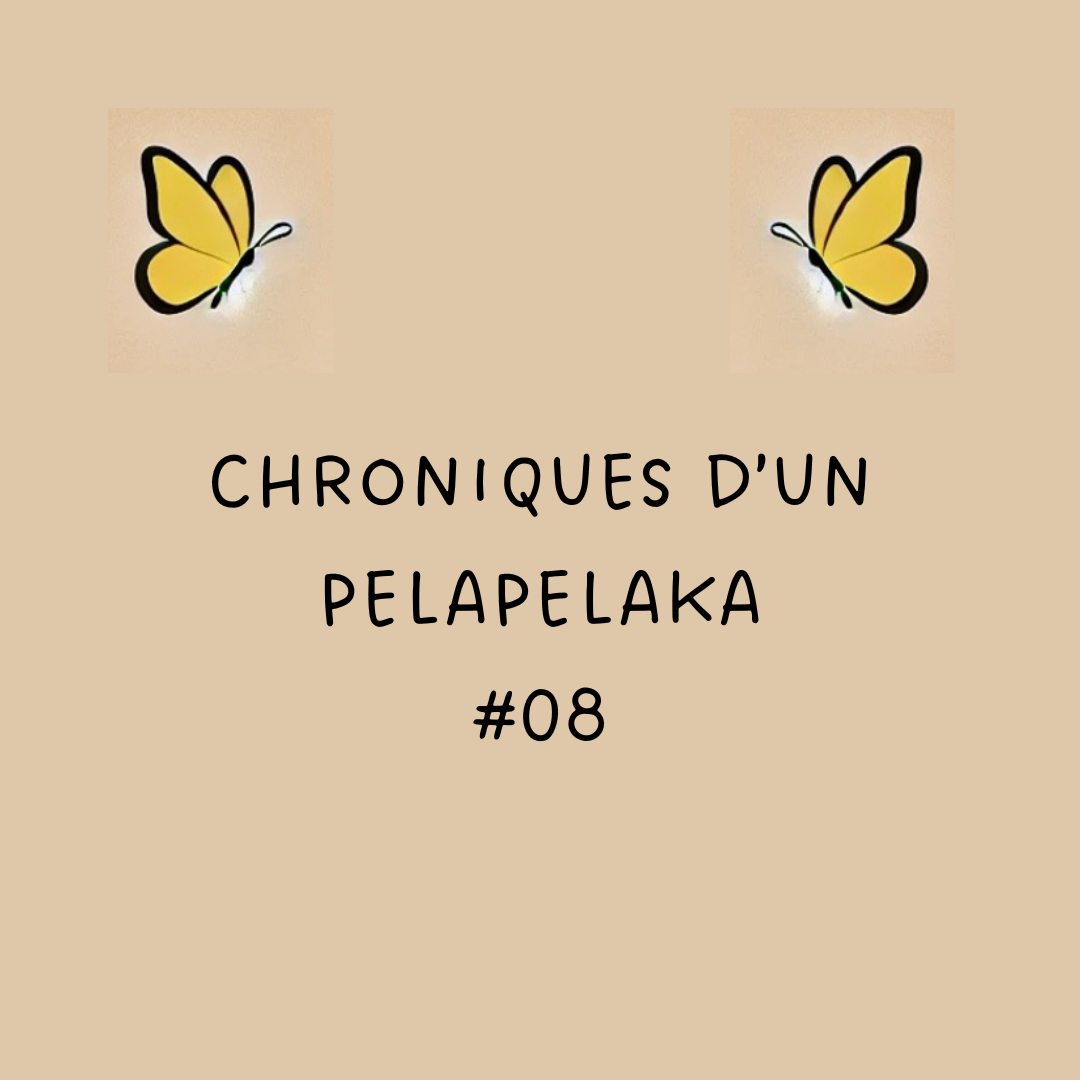Cher Pelapelaka,
Je crois qu’il nous faut vomir nos interrogations, nos angoisses, nos chagrins et nos colères.
Tout plutôt que d’avaler ce qui, à terme, ferait de nous une montagne de rancœur et d’aigreur, d’agressivité et de méchanceté.
Nous sommes le 14 décembre. Jour funèbre. Je ne veux pas être en colère de bon matin. La télévision n’est, pour le moment, pas encore allumée. Peut-être ne le sera-t-elle pas de la journée. Pour l’instant, je baigne dans une pénombre silencieuse. Il est encore tôt, mais je sais que là où mes pensées me mènent, il est déjà très tard.
À Mayotte, on commémore. On parle même d’anniversaire. Suis-je la seule à avoir en tête une célébration accompagnée d’un gâteau et de cette petite musique entêtante quand j’entends le mot ‘anniversaire’ ?
Plutôt que de débattre avec moi-même sur le sens des mots, sur mes propres biais : je préfère vomir.
Résilience aussi, je te vomis.
Je ne suis pas résiliente. Je suis acculée et désespérée. Et désespérément, je cherche la voie du bien-être et de la paix.
Résilience… aptitude d’un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques, nous dit le Larousse.
Personne ne vit ici. Tout le monde survit. Malgré la multiplication des traumas. Malgré les catastrophes. Malgré la violence institutionnelle. Malgré le mépris. On avance parce qu’on n’a pas le choix. Inch’Allah, ça ira mieux demain.
Il n’y a pas de résilience. Il y a juste des gens qui doivent faire face à une machine politique et administrative défaillante, qui les laisse, gueule béante, dans leur bâti en dur sans toit, dans leurs cases en tôle magnégné, parfois sur le bord de la route, en train d’agoniser.
Nous ne voulons plus être assignés à la résilience. Nous voulons une belle vie.
Ce matin, j’ai pris mon téléphone, que j’ai reposé au bout de quelques minutes. L’algorithme m’inonde de vidéos, de photos et de messages commençant toujours de la même manière :
« Il y a un an… »
Je reconnais quelques personnes derrière les photos de profils lisses. Je sais ce qu’elles ont traversé. Je comprends qu’à leur manière, elles aussi, aient envie de vomir. La plupart des autres me sont totalement inconnues. La curiosité me pousse à vouloir savoir qui sont ces personnes qui partagent des souvenirs traumatisants qu’elles n’ont pas vécus et expliquent les conséquences dramatiques qu’elles ne subissent pas.
Eux, ce sont des chercheurs, des architectes, des représentants d’ONG, des professeurs et des journalistes, des avocats, des fonctionnaires, reconvertis… Des gens bien comme il faut qui, face à l’horreur, ont pris leur plus belle plume pour « témoigner de l’Histoire ». Sinon, tout était aussi fait avec un téléphone… parce qu’il n’y avait pas d’électricité et qu’on devait faire au mieux. Après tout, personne n’était préparé.
Ceux qui sont arrivés en renfort quelques jours plus tard ont eu plus de temps. Tous sont désormais écrivains en herbe ou poètes, réalisateurs ou photographes. Ils ont publié des ouvrages, organisé des expositions, participé à des festivals pour représenter leur travail, témoignage unique de l’horreur qui s’est déroulée sur ce bout de territoire, le plus jeune et le plus pauvre de France.
Pauvre Mayotte.
Pendant ce temps, pour les personnes ayant subi de plein fouet la catastrophe météorologique, peu de choses ont changé. Il faut dire que bien avant tout cela, peu de choses changeaient déjà.
Connaît-on dans le monde si petit territoire, joyau de bleu lagon et de vert forêt, cumulant tant de difficultés en si peu de temps écoulé ?
Le temps passe et tout ne fait que se dégrader. Ce n’est pourtant pas faute d’alerter. Que se passe-t-il ? Pourquoi les doléances de Mayotte ne parviennent-elles pas, à défaut de se transformer en quelque chose de positivement concret, à émouvoir ?
En me remémorant quelques visites officielles de ces dernières années, je me dis que le fait d’accueillir toute personne venant de l’extérieur, quelle qu’elle soit, quelles que soient les nouvelles qu’elle apporte, avec une multitude de colliers de fleurs, de jolis chants entonnés en chœur et une scénographie digne des plus grandes représentations nollywoodiennes, ne doit pas aider.
Je les imagine, ces officiels, chuchotant entre deux « Woyé mawa » :
- Mais qu’est-ce que tu m’as raconté comme ânerie, François ? Ils ont l’air d’aller très bien, tous ces petits Mahorais!
Ce à quoi François, dépité, tenterait de répondre :
- Je vous jure, Monsieur le Président, que la situation est grave. Ils n’ont plus de maisons, plus d’eau, plus d’accès à l’école… Ne vous fiez pas à leurs sourires, c’est dans leurs coutumes!
On pourrait excuser ceux qui ne sont là que de passage. Mais nous, quelles excuses avons-nous ? N’avons-nous rien appris ? Rien compris ? Rien retenu depuis 2011 et la fameuse “révolte mabawas” ? Plus de quarante jours de mobilisation contre la vie chère, où tout un territoire s’est retrouvé bloqué. Un mort. Un enfant éborgné. Tout cela pour quoi ?
Le 20 octobre 2011, Thani Mohamed Soilihi, sénateur de Mayotte, s’adressait ainsi au Premier ministre : « Hier, Ali El Anziz, jeune Mahorais de 39 ans, qui manifestait pacifiquement contre la vie chère, est brutalement décédé après une charge des forces de l’ordre. Quelques jours auparavant, un enfant de 9 ans perdait un œil après un tir de flash-ball de la police. »
Il poursuivait : « On le sait, Mayotte est frappée depuis plusieurs semaines par une grève générale sans précédent contre la vie chère. La colère des Mahorais est grande et la mobilisation ne faiblit pas. L’île se trouve aujourd’hui dans une situation explosive. La situation à Mayotte est telle que des mesures d’urgence fortes, propres à permettre le développement de l’économie, doivent être adoptées immédiatement. Un tel investissement est indispensable au moment où Mayotte prend un tournant historique. L’exaspération de la population ne doit pas être prise à la légère. Nous attendions plus que les “mesurettes” méprisantes annoncées récemment par Mme la ministre de l’Outre-mer. »
Ce n’est pas le Premier ministre mais la ministre de l’Outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, Marie-Luce Penchard, qui lui répondit après avoir adressé ses condoléances et expliqué qu’une enquête était en cours : « D’autres sujets peuvent être abordés en vue d’améliorer au plus vite le quotidien de nos compatriotes mahorais. Des mesures existent dans le cadre du processus de la départementalisation. »
C’était il y a plus de quatorze ans. Une éternité.
J’aimerais dire que le quotidien des Mahorais s’est amélioré, mais ce serait mentir. La mer bleue et la campagne verdoyante ne peuvent pas faire oublier les crises sociales, économiques et environnementales à répétition.
En 2013, le quotidien à Mayotte fut rythmé par de nombreux black-out, parfois de plus de dix heures, sur tout le territoire.
En 2014, le cyclone Hellen causa de nombreux dégâts, notamment dans la commune d’Acoua. Face au désespoir des sinistrés, la campagne des élections municipales suivit son cours. Les habitants s’en étaient émus. J’espère qu’ils vont bien.
À l’époque, les réseaux sociaux n’étaient pas utilisés comme aujourd’hui. Cela ne faisait que deux ans que le haut débit était enfin installé sur le territoire. Aussi, qui se souciait de ce bout de France revendiqué par d'autres, perdu au milieu du canal du Mozambique ?
En 2015, la problématique de l’eau a commencé à faire son grand retour. On parlait alors de menaces de restriction en eau potable à cause d’une possible sécheresse. C’était épisodique. Cela devait être temporaire. Les années suivantes, il a pourtant bien plu, mais ce n’était jamais assez. Parce que ce n’était pas un problème de pluviométrie, mais bien d’infrastructures, de compétences et, peut-être par-dessus tout, d’intégrité. Cela fait désormais dix ans que la situation ne cesse d’empirer, faisant que des habitants se retrouvent parfois pendant quatre jours sans eau courante.
En 2016, la grève générale a bloqué tout un territoire. Naissaient alors les opérations « Mayotte île morte ».
En 2018, il fallait de bonnes chaussures de marche pour se rendre au travail, avec tous les carrefours et routes bloqués par les habitants pour dénoncer la montée de l’insécurité et de la violence. Il faut dire que cela faisait plusieurs années que les discours officiels tentaient de nous faire croire que le « sentiment d’insécurité » était dans nos têtes et que les chiffres montraient qu’il n’y avait pas plus de problèmes qu’ailleurs.
Puis il y a eu les tremblements de terre qui ont plongé, pendant plusieurs semaines en 2019, le territoire dans une panique absolue, sans aucune information officielle durant de longs jours, laissant place aux spéculations les plus terrifiantes. Des villages entiers se retrouvaient à dormir sur des terrains de football, de peur que leurs maisons ne leur tombent sur la tête.
Des bâtiments administratifs, des écoles, des maisons s’en souviennent encore aujourd’hui, avec les fissures apparues depuis. Le musée de Mayotte n’y a d’ailleurs pas survécu. Il est toujours fermé pour « réhabilitation ». Sa préfiguration n’était ouverte au public que depuis 2015 et il venait à peine de recevoir sa labellisation « musée de France ». Nous arrivons en 2026 et nous n’avons toujours aucune nouvelle d’une possible réouverture. Mais ceci est une autre histoire.
En 2019, toujours, quelle ne fut pas notre surprise lorsqu’on nous expliqua enfin que la crise sismique était liée à la naissance exceptionnelle d’un volcan sous-marin. Une rareté mondiale qui enthousiasmait la communauté scientifique. Pas de chance pour nous : l’île, elle, s’était, entre-temps, affaissée de plusieurs dizaines de centimètres. Et comme cela ne suffisait pas, réchauffement climatique oblige, les grandes marées sont de plus en plus nombreuses et dangereuses : presque tous nos villages sont côtiers. Quand les vagues ne menacent pas nos maisons, ce sont nos routes qui sont submergées.
En parlant de routes… En 2022, les chaussées se sont effondrées, coupant net la circulation pour aller du nord au centre. Pendant plusieurs semaines, il fallait marcher des kilomètres parce qu’une seule et même route, datant des années 1990, devait être réparée. Mais pourquoi, depuis tout ce temps, des travaux n’ont-ils pas été faits ? Pourquoi le réseau routier de Mayotte, composé de 90 kilomètres de routes nationales et de 140 kilomètres de routes départementales, n’est-il pas adapté au trafic actuel ?
Nous ne sommes plus dans les années 1990, où il n’existait que quelques voitures par village. Désormais, chaque foyer possède son véhicule, parfois même deux. Résultat : le matin, il faut au minimum trois heures pour parcourir dix-sept kilomètres. Même son de cloche le soir pour rentrer chez soi.
Des familles se lèvent à trois heures du matin pour espérer être à l’école ou au travail à sept heures. Elles quittent le travail à dix-sept heures pour arriver chez elles après dix-neuf heures. Le tout sur des routes peu ou pas éclairées et, il faut le dire, peu ou pas sécurisées.
Je pourrais parler des impôts exorbitants qu’il nous est demandé de payer. Je ne sais toujours pas pourquoi, puisqu’il n’y a, à ce jour, aucun service public à la hauteur…
Aussi, se retrouver, au lendemain d’un cyclone, coupés de monde, sans serviettes hygiéniques, sans eau ni électricité, sans toit, sans moyen de se déplacer, sans vivres suffisants, sans perspective de reconstruction et de bien-vivre, qu’est-ce donc, si ce n’est la continuité ?
Les enfants en difficulté ? Cela fait des années. Certains sont désormais des adultes qui ont laissé d’autres enfants derrière eux. Que fait-on réellement pour eux ? Ils continuent d’être seuls. Ils continuent de ne pouvoir aller à l’école. Et quand ils le peuvent, ils restent bloqués sur un territoire qui les a vus grandir et qui leur fait ressentir qu’ils ne sont pas les bienvenus.
Pauvres enfants.
Les adultes abandonnés ? Ils ont l’habitude. Ils s’en remettront. Ce fut simplement très difficile, au début, de voir autant de brassage d’air autour de nous pendant que nous étions occupés à chercher des bâches pour recouvrir nos toitures afin de nous protéger de la pluie. Et puis, on sentait mauvais, avec la chaleur et le manque d’eau. On était fatigués de veiller la nuit, en plein couvre-feu, de peur que ceux qu’on entendait passer avec leurs chiens ne viennent nous rendre visite. Pour ne pas dormir, les moustiques nous aidaient.
Aujourd’hui, rien ou presque n’a changé. Les gens ont arrêté d’attendre ce qui ne viendra jamais. Enfin, je l’espère pour eux. D’autres demandent encore de l’aide, ne serait-ce que pour être écoutés. Je crois qu’on n’a jamais autant parlé de santé mentale qu’aujourd’hui. Parce que tout le monde en a assez : trop d’incompréhension, trop de fatigue, trop de désespoir.
Je crois que chacun aimerait simplement tourner la page : vomir ce qui reste d’aigreur dans l’estomac, comme il le peut, si tant est qu’il le puisse.
Parce que c’est dur. Et que des larmes ne sauraient suffire à nous faire aller mieux quand on est juste vide et que l’on cherche le moyen de se remplir à nouveau de belles choses.
Voilà. J’ai vomi et je vais mieux.
Je vais attendre un peu, puis j’irai me remplir la panse. Je choisirai avec soin des plats d’amour et de douceur. Je mangerai doucement. Je savourerai chaque instant.
Je ne veux pas de résilience dans la vie. Honte à ceux qui nous martèlent ce mot pour nous le faire devenir nôtre.
Je veux bien vivre et non survivre. Je veux de l’amour, du confort et de la douceur.
Je te le souhaite aussi. Tu le mérites. Nous le méritons tous.
Où que tu sois, surtout, prends soin de toi.
Pelapelakament tienne,
Abby